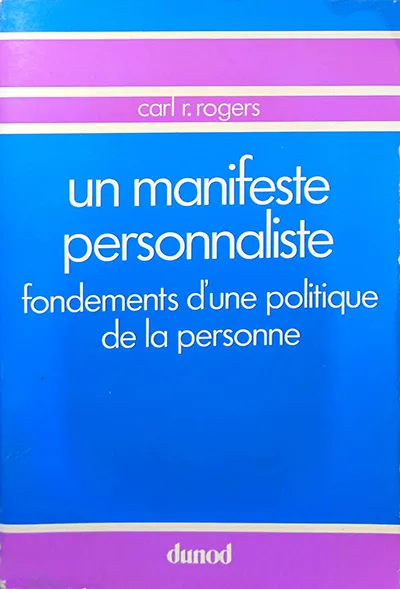Carl R. Rogers, Un manifeste personnaliste : Fondements d’une politique de la personne, (On personnal power : Inner strenght and its revolutionnary impact), Dunod, 1979.
« Une révolution tranquille est en marche dans presque tous les domaines. On peut espérer qu’elle nous fera progresser vers un monde plus humain, plus centré sur la personne. » (p. 235).
Dans ce livre, Carl Rogers se place sur le terrain politique. Il considère que dans la société occidentale, la source principale de la pathologie psychologique et sociale réside dans la « dissociation » entre le comportement conscient des individus, influencés par des modèles sociaux externes stricts, et leurs besoins intérieurs profonds et inconscients, leur processus organismique (pp. 199-200).
Le politique, selon Rogers, implique le pouvoir et le contrôle, que ce soit sur soi-même ou sur autrui, et se manifeste par les décisions qui régulent ou influencent les pensées, sentiments ou comportements d’une personne (p. 4).
Selon Rogers, le contexte social, politique, économique et culturel dans lequel une personne évolue depuis sa naissance joue un rôle déterminant dans la formation de sa personnalité, influençant directement sa santé psychique. Il estime que l’« aliénation » de l’individu vis-à-vis de ses processus internes n’est pas innée, mais acquise, particulièrement dans les cultures occidentales. Cette déconnexion interne se traduit par des comportements contradictoires qui peuvent se manifester à différents moments :
« Cette dissociation qui existe chez la plupart d’entre nous sert de modèle et de fondement à toute pathologie psychologique de l’espèce humaine, c’est aussi le fondement de toute sa pathologie sociale. » (p.199-200).
Une révolution tranquillement subversive
Pour Rogers, « La politique est présente dans la pratique psychologique et sociale courante qui impose trop souvent pouvoir et contrôle. » Il cherche à comprendre dans quelle mesure « les personnes désirent, s’efforcent d’obtenir, possèdent, partagent ou cèdent le pouvoir et le contrôle qu’ils ont sur autrui et/ou eux-mêmes. » (p. 4). S’il n’appelle pas à l’insurrection, sa « révolution tranquille » (ainsi qu’il la définit) est en réalité profondément subversive. En invitant à un renversement complet des rapports humains, il s’agit de transformer radicalement les rapports de pouvoir dans les domaines thérapeutique, éducatif et politique :
« Ce n’est pas que cette approche donne du pouvoir à la personne c’est qu’elle ne lui en enlève jamais. Qu’un point de départ en apparence si innocent ait des implications si véritablement révolutionnaires peut sembler surprenant. » (p. XII).
Dans cette révolution copernicienne de la psychothérapie, les thérapeutes ne sont plus le centre du monde. Ils doivent abandonner toute volonté de pouvoir dans la relation avec les patients, que Rogers préfère d’ailleurs appeler des « clients » pour s’éloigner du rapport de domination existant dans le domaine médical. Dans l’approche centrée sur la personne, la relation entre thérapeute et client est une rencontre entre deux êtres humains. Le thérapeute n’est pas un expert omniscient face à un patient passif, attendant des directives pour orienter sa vie.
La tendance actualisante est politique
Au travers du concept de « tendance actualisante » affirmant que chaque organisme est naturellement porté à développer toutes ses potentialités pour favoriser sa survie et son épanouissement, Rogers postule que chaque individu, dans son ensemble, tend vers l’autonomie et l’unité, poussé par cette dynamique interne à réaliser ses possibilités. La tendance actualisante est une force vitale intrinsèque qui encourage la croissance, le maintien et la reproduction. Rogers considère ce phénomène comme la véritable essence de la vie :
« C’est donc ici, au cœur du mystère touchant à ce qui permet à un organisme de “faire tic-tac”, que se trouve une première pierre importante pour notre réflexion politique. » (p. 193).
C’est ainsi que Carl Rogers, peut-être influencé par son éducation religieuse et son intérêt pour les phénomènes naturels, parvient à concilier science et spiritualité.
Rogers considère que la tendance actualisante est une base pour la liberté et l’émancipation qui implique aussi que l’individu se dirige lui-même vers son épanouissement personnel sans contrôle externe. Rogers insiste sur cette idée d’autonomie, affirmant que dans un état naturel, l’organisme cherche à se libérer des influences extérieures pour atteindre l’indépendance (p. 193).
Différentiation de l’ACP par rapport à la psychanalyse et au comportementalisme
Carl Rogers place les différents processus thérapeutiques sur une échelle qui concerne le pouvoir et le contrôle. « À un bout de l’échelle se trouvent les Freudiens orthodoxes et les Béhavioristes orthodoxes [comportementalistes] qui croient en une politique de contrôle autoritaire ou élitiste des personnes « dans leur propre intérêt », soit pour parvenir à une meilleure adaptation au statu quo, ou au bonheur, ou à la satisfaction, ou à la productivité, ou à toutes ces choses réunies ». À l’autre extrémité de l’échelle, on retrouve la thérapie centrée sur la personne, qui valorise l’autonomie et la capacité des êtres humains à s’autodiriger. Cette approche défend fermement le droit de chaque personne à choisir sa propre voie et à prendre la responsabilité totale de ses choix dans la relation thérapeutique. Le rôle du thérapeute, bien qu’important, se réduit essentiellement à celui de facilitateur ou de catalyseur (p. 17).
L’avènement d’une « personne nouvelle »
Rogers appelle à l’avènement d’une « personne nouvelle », capable de révolutionner les relations humaines grâce à sa capacité d’être pleinement ouverte aux deux sources essentielles, les données fournies par ce qu’elle ressent au dedans de soi, et les données fournies par ce qu’elle ressent à partir du monde extérieur. Cette personne nouvelle aurait vécu selon des orientations qui « seraient plus sages que les commandements des dieux ou les directives des gouvernements. Elles pourraient devenir le courant vivifiant d’un avenir constructif. » (p. 201). La révolution personnaliste, selon Emmanuel Mounier (dans son ouvrage intitulé Manifeste au service du personnalisme)ou selon Carl Rogers, ne chercherait pas à détruire l’ordre établi par la violence. Rogers misait plutôt sur un mouvement naturel de l’humanité :
« Je vois venir cette révolution non pas sous la forme d’un grand mouvement organisé, d’une armée avec des canons et des bannières, de manifestes et de déclarations, mais grâce à l’apparition d’un nouveau type de personnes en train de poindre à travers les feuilles et les tiges mourantes, jaunissantes, en putréfaction, de nos institutions en voie de dépérissement. » (p. 211).